Rouvrir mon blog fermé depuis un an pour cause de pandémie et de mise à l’arrêt des musées, théâtre et cinéma ne correspond malheureusement ni à l’accès retrouvé de ces lieux culturels, ni à un semblant de retour à une vie dite « normale ». Rouvrir mon blog signifie seulement avoir trouvé de nouvelles occasions d’écrire et de partager mon enthousiasme.
Cette première opportunité coïncide avec la sortie en librairie depuis quelques semaines de l’ouvrage de deux trentenaires, Léa et Hugo Domenach, enfants de mes amis Michèle Fitoussi et Nicolas Domenach, petits-enfants de Jean-Marie Domenach, l’un des fondateurs de la revue Esprit.
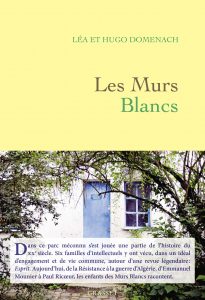
Les auteurs sont partis sur les traces d’une histoire qui coïncide avec un morceau de leur mémoire familiale. Les Murs Blancs (Grasset, 2020) restitue l’aventure d’un groupe d’intellectuels qui, autour du philosophe Emmanuel Mounier, fonde dans les années 1930 un mouvement et une revue : Esprit. L’aventure de ces jeunes gens issus des mouvements de jeunesse du catholicisme sociale a eu pour cadre une propriété située à Châtenay-Malbry, baptisée joliment Les Murs Blancs.
Deux événements ont présidé à l’écriture de ce livre : le risque de voir la mémoire de ce lieu disparaître et l’élection d’Emmanuel Macron. Dès l’accès à ses fonctions, le Président a, en effet, revendiqué son expérience d’assistant de Paul Ricœur qui vivait aux Murs Blancs. Le lieu a ainsi été remis en lumière.
Si Hugo et Léa Domenach ne se sentent pas être directement les héritiers intellectuels de cette communauté, leurs engagements dans la société civile ou dans leurs activités (lui est journaliste et actuellement responsable éditorial à l’ina, elle est documentariste travaillant en particulier sur la question des inégalités hommes/femmes), font d’eux des observateurs légitimes de cette épisode inédit. Enfants, ils allaient jouer dans le grand et beau parc de la propriété tout comme l’avait fait leur père, Nicolas, qui a grandi là. Ils allaient visiter dans cette maison de famille leur grand-père Jean-Marie, surnommé Jim, et leur grand-mère Mamita. C’est avec la disparition de cette première génération de murblanquistes qu’ils ont commencé à prendre la mesure des enjeux de cette aventure majeure de la vie intellectuelle et politique du XXème siècle. En écrivant ce livre, ils se sont appropriés cette histoire dont ils nous font partager les espoirs et les déceptions.

L’ouvrage constitue un témoignage intellectuel et historique précieux, étayé par les interviews des derniers témoins, des collaborateurs de la revue Esprit, des enfants et petits enfant des « murblanquistes », par l’accès aux archives personnelles des familles, par les ouvrages écrits par certains habitants (dont les Souvenirs de Paul Fraisse, la biographie d’’Emmanuel Mounier par Jean-Marie Domenach) ou les entretiens de Paul Ricœur avec François Dosse.
Nous revivons ainsi les enjeux des plus grandes batailles politiques et idéologiques de l’après-guerre et surtout le rôle de ces intellectuels engagés dans la vie politique. Mais le ton du livre et sa facture n’en font en aucun cas un ouvrage universitaire ou savant. Les auteurs jettent un regard à la fois respectueux et critique, bienveillant et distancié par deux générations, face à une utopie qui n’a pas fonctionné humainement.
« Penser du possible » est le socle à partir duquel le philosophe Emmanuel Mounier et ses amis de la Revue Esprit travaillent. Mounier décrit comme « sérieuse, grave, occupée de problèmes, inquiète d’avenir » sa génération à laquelle appartiennent aussi Sartre, Nizan, Aron ou Camus, nés en 1905 comme lui.
« En état de guerre spirituelle », homme de foi en Dieu et en l’homme, Mounier sera en quelque sorte le gourou de la communauté des Murs Blancs. « Mounier prenait tout de suite une place dans la vie des gens », témoigne le philosophe Paul Thibaud. Fondateur de la revue Esprit en 1932, Mounier rêve de lui donner une dimension nternationale. Mais il veut plus. Il veut regrouper ses amis pour mieux organiser leurs rêves de changer le monde. Il veut créer un centre Esprit, un lieu où ils vivraient ensemble, où seraient abrités la revue et le mouvement Esprit ainsi qu’un centre pédagogique.
Avec l’aide de Paul Fraisse, il trouve en 1939 le lieu idéal à Châtenay-Malabry, une grande propriété dans une banlieue qui ressemblait encore à la campagne. Mais la guerre et les engagements de chacun dans la Résistance retardent le projet qui verra vraiment le jour après la Libération. Le centre éducatif sera abandonné. Les Murs Blancs deviendra le lieu d’une vie communautaire et celui du centre Esprit.

Autour d’Emmanuel Mounier, les familles de quatre intellectuels chrétiens, Henri-Irénéé Marrou, Jean Baboulène, Paul Fraisse et Jean-Marie Domenach s’installent dans la propriété après l’avoir rendue habitable. Ils seront bientôt rejoint par Paul Ricoeur, qui est protestant. Mounier rédige une « Constitution murblanquiste » qui est signée le 10 décembre 1946. Les termes de ce document sont extraordinaires : un mélange d’humour, de malice et de vision utopique qui posent les bases d’une communauté idéale. « Les Murs blancs ne sont pas tout. Les Murs Blancs sont, c’est tout. Et c’est déjà beaucoup ». Ou encore : « Il n’y a aux Murs Blancs, ni propriétaires, ni locataires, ni oppresseurs, ni opprimés. Les Murs Blancs ne sont pas une propriété. Cette impropriété est collective ». Il serait fastidieux de recopier l’intégralité de cette constitution qui s’inscrit entre un manifeste anticapitaliste et un poème de Boris Vian, mâtiné de références à Rousseau ou à Goethe. C’est magnifique !
Mais la réalité va rapidement rattraper et contrarier les belles intentions du « vivre ensemble ». Rivalité entre les cinq familles pour la répartition des lieux, rivalité de pouvoir entre les membres à l’intérieur de la revue et dans la gestion de la propriété, rivalité affective face au « père spirituel »…Un drame va mettre un terme à cette première époque qui s’annonce plus compliquée que prévue : la mort brutale d’Emmanuel Mounier, le 21 mars 1950. Les hommages seront nombreux et unanimes, le chagrin aux Murs Blancs immense.

Une nouvelle page s’ouvre. La vie intellectuelle de la communauté se ressert à Châtenay autour de réunions et de conférences, dont celle du dimanche après-midi qui perdurera jusqu’aux années 1970. L’activité de la revue s’organise à l’extérieur. C’en est fini du « centre Esprit ». Et il faut trouver un « successeur » au père disparu. C’est alors que Paul Ricœur entre en scène. Mais là encore, certains espoirs vont vite être déçus : Ricœur est un « maître penseur plutôt qu’un maître à penser ». Il n’est pas homme à diriger ou à arbitrer des problèmes : il ne sait pas dire non et déteste les responsabilités. C’est néanmoins une nouvelle dynamique qui s’installe, sans pour autant régler les tensions de cohabitation de la communauté.
La revue Esprit continue à jouer un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle française et à l’étranger. Ses positions concernant la guerre d’Algérie, la torture et la décolonisation, la lutte contre le totalitarisme communiste ou la construction de l’Europe seront majeures dans les débats.
Léa et Hugo Domenach décrivent avec finesse la fin progressive du rêve des Murs Blancs qui s’amorce au moment de l’éclosion de Mai 68. Une fracture générationnelle va se creuser entre les parents et les enfants qui ont grandi. Ceux-ci se sont éloignés des valeurs du catholicisme qui faisaient partie de l’ADN familial. Et la révolution sexuelle qui explose dérange les ainés. Ils ne comprennent rien à la liberté des moeurs, sont opposés par principe à l’avortement et admettent difficilement la réalité de l’homosexualité. Le suicide d’Olivier Ricœur en 1971 cristallisera une partie des failles humaines et intellectuelles des Murs Blancs, en particulier l’échec de ces intellectuels à porter à leurs enfants autant d’intérêt qu’à leurs combats politiques ou théoriques, passant à côté d’une transmission constructive et d’une attention suffisante aux changements de l’époque. Paradoxalement, cette communauté composée de brillantes personnalités, d’universitaires aux enseignements puissants, de militants opposés à toute forme d’injustice depuis l’Occupation, qui a formé toute une génération de chercheurs, de philosophes, de journalistes, d’écrivains, d’artistes, d’hommes politiques (et pas des moindres puisque le Président Macron doit beaucoup à Ricœur), a su probablement mieux transmettre à ses disciples et à ses fils spirituels qu’à sa propre famille. Néanmoins, pour les petits-enfants Domenach, demeure une certitude : « Les murs peuvent tomber, les hommes et les femmes disparaître, mais les idées, les valeurs et les combats, eux, pourront toujours renaître. »
LES MURS BLANCS de Léa et Hugo Domenach Grasset, 2020, 20 €







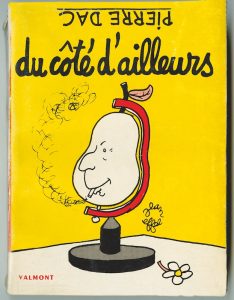



























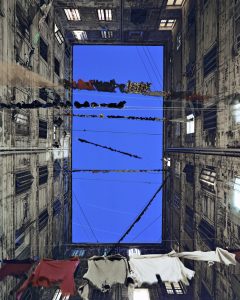



















![[Ʒaklin] Jacqueline, Ecrits d’Art Brut](http://corinneb.net/wp-content/uploads/2020/01/143-jacqueline_raphae_l_mesa-2.jpg)




