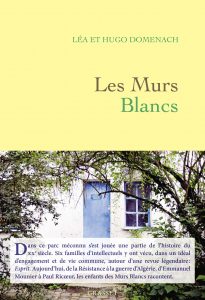Paradoxe en ces périodes où nous avons plutôt vécus devant des portes closes, des devantures fermées, des lieux de cultures bâillonnés : un espace s’est ouvert au public, un espace dans lequel nous ne nous attendions pas à pénétrer, celui du cabinet du psychanalyste ou, plus précisément, celui du temps du travail analytique.

Nous avons été plus de seize millions à suivre la série En thérapie sur arte, version française de la série israélienne BeTipul et de sa version américaine In treatment. Nous avons aimé partager l’écoute du psy Philippe Dayan (hissant à raison le comédien Frédéric Pierrot au rang de star), nous nous sommes attachés à chaque patient, projetant éventuellement dans leurs histoires des questionnements qui nous assaillent.
Un ouvrage à la sortie discrète, Suivre Pauline, nous invite à ouvrir à nouveau la porte de l’antre si privée d’un thérapeute. A travers son ouvrage qu’il qualifie de témoignage, Sidney Cohen nous entraine sur les traces de Pauline, jeune femme à la vie cabossée, qui a entrepris avec lui une cure sur plusieurs années. L’issue de cette analyse se révélera malheureusement tragique.
Celle que l’auteur désigne comme un « drôle d’oiseau » se dévoile au fil des pages et au fil des séances, nous offrant véritablement un récit : histoire familiale très lourde (mère autrichienne, père d’origine italienne sans doute un peu collabo pendant la guerre), relations très violentes entre les parents et avec leurs enfants, expérience de quelques années dans le giron de l’Education nationale en tant que prof d’allemand (pour faire plaisir à sa mère), fuites dans le sexe et la drogue pour tendre à une liberté que son enfance et son adolescence lui avait arrachée.
Comme le souhaite l’auteur, nous « suivons » Pauline autant qu’elle est suivie par la thérapie. Nous déplorons avec lui sa relation dévorante avec Jean-Paul, l’homme qu’elle a « dans la peau ». Grand toxico, il va l’entrainer dans un tourbillon funeste. Du pétard à l’héroïne, elle va tout essayer, tout partager avec Jean-Paul jusqu’à se charger elle-même de trouver la dope et se retrouver dans le monde impitoyable des dealer. Il lui faut éventuellement « coucher » pour récupérer la drogue, alors Jean-Paul la frappe et la traite de salope….L’emprise de cet homme met l’analyste dans une situation intenable : il aspire à hurler son sentiment de révolte contre ce tyran. Mais telle ne peut être sa position. Il doit se retenir de donner un avis, un conseil, une réponse. C’est le fil de la pensée de Pauline qui doit suivre son cours.

Alors que cette dernière cache toujours ses mains dans ses poches lorsqu’elle arrive à leurs rendez-vous, l’auteur/psy va inopinément découvrir que le corps qu’elle dissimule dans un grand blouson de cuir est abimé voire mutilé : Pauline a subit l’amputation de quelques phalanges à la suite d’une infection provoquée par une piqure de barbiturique dans le dit doigt. Ce « secret » qu’elle va finalement livrer à son analyste prendra une importance centrale au cours de plusieurs séances, une importance symbolique de sa relation si ambivalente avec « son » Jean-Paul : ce doigt perdu est l’objet de sa douleur et de sa jouissance dans une histoire d’amour et de perte d’elle-même.
Nous apprenons incidemment que Pauline a eu des relations sexuelles avec son frère lorsqu’ils étaient ados, avec l’un de ses oncles également… Le sexe occupe chez elle une place tout à fait séparée des sentiments.
Petit à petit, Pauline va apprivoiser son psy. Ce qui est très fort et très réussi dans ce texte, au-delà du portrait que Sidney Cohen dresse de Pauline, c’est la restitution très sensible des étapes de la relation entre analysé et analysant sur fond des grandes questions que se pose le second : quel est le sens de sa position, de son métier, des ses automatismes ? Quel décalage existe-t-il entre les attentes du patient et les réponses qu’il peut donner où « (il) éprouve le sentiment d’être au bord de la trahison, de l’imposture, d’être l’acteur d’une vaste tromperie.» L’auteur décrit parfaitement ces aller-retours entre les séances, ces moments où il sent que « ça prend », les moments d’avancées du travail, puis les reculades : « C’est bien souvent à l’inconnu que nous avons affaire et nos prétentions à maitriser, à prévoir, à anticiper, sont bien souvent rabattues. Une vrai leçon d’humilité ».
Pauline se bat, se débat. Elle tente à plusieurs reprises de renouer avec ses parents. En vain. Elle tente de quitter Jean-Paul, elle y parviendra finalement. Mais tout tient à un fil, très ténu…. Elle s’accroche à sa thérapie dont elle semble conquérir chaque rendez-vous, elle rechute souvent et passe par des hospitalisations fréquentes. Le thérapeute, qui s’est attaché à sa patiente, vivra des moments de découragement. Et, malgré toutes les précautions possibles, le drame survient. Même séparée, Pauline n’accepte pas le suicide de Jean-Paul…Elle le suivra. Son emprise la poursuivra jusque dans la mort.
Dans sa postface, Sidney Cohen explique sa démarche. Il a voulu revenir des années plus tard sur ce « cas Pauline », elle qui lui envoyait quelquefois des lettres qu’elle concluait toujours par un joli « Affectueusement ». Doit-il se reprocher un « échec thérapeutique » ? Doit-il constater son impuissance à avoir pu changer le cours des choses ? En choisissant de nous livrer l’histoire de Pauline et la sienne dans une langue qui évite sciemment le jargon psychanalytique, Sidney Cohen dit vouloir redonner sa place au lien thérapeutique et à sa dimension humaine. Il y réussi pleinement.
Sidney Cohen SUIVRE PAULINE Préface de Jacques Hochman éditions Fauves, 2021 Se procurer l’ouvrage : - sur le site www.fauves-editions (édition numérique ou papier) - le commander chez votre libraire

 Sidney Cohen
Sidney Cohen