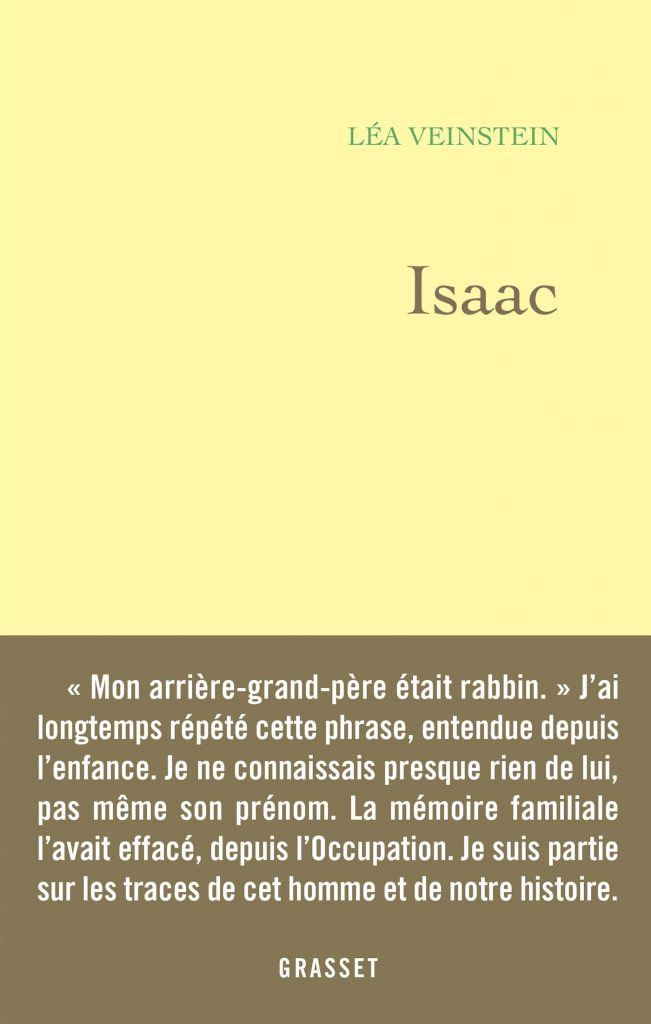
Isaac, le premier récit de Léa Veinstein, est une enquête et une quête.
Enquête sur son arrière grand-père à qui elle (re)donne un prénom, quête de ses origines familiales, de la mémoire familiale, de son identité. Isaac est aussi une adresse à son père, très présent dans cette double investigation.
En choisissant d’écrire à la première personne, Léa Veinstein nous entraine dans ses pas, à la recherche de cet ancêtre dont elle a toujours (et seulement) su qu’il était rabbin. Lorsqu’on lui demandait si elle était juive, elle répondait, comme si cette déclaration suffisait à constituer une identité : « Mon arrière grand-père était rabbin ».
La première partie du livre nous conduit jusqu’à la synagogue de Neuilly, rue Ancelle, où Isaac Saweski, le père de sa grand-mère paternelle, fut d’abord hazan, celui qui chante (on dit aussi pompeusement ministre officiant), une sorte de numéro deux du rabbin. Pendant l’Occupation, Isaac remplaça le rabbin Meyers. Ce dernier, parti loin de Paris, fut rattrapé et déporté à Auschwitz. Léa découvre au fil de ses recherches que son arrière grand-père, resté à Neuilly pour perpétuer les offices de la synagogue, était détenteur d’une carte de légitimation, une garantie pour lui et sa famille d’être tenus en dehors de toute mesure d’internement. Cette découverte voile tout à coup Isaac d’un soupçon de collaboration, dont, sans doute il ne fut rien. A cette occasion, l’auteur (nous) apprend que les synagogues parisiennes étaient restées ouvertes pendant la guerre jusqu’en 1944, même si fin 1943, le grand rabbin de France exhorta tous les Juifs à se cacher.
En découvrant son arrière grand-père, Léa redécouvre sa famille. Elle comprend que Mamie Gâteaux, un « surnom qui ne lui allait pas du tout », vivait dans ce qu’on appelle la haine de soi. En rupture avec son père, elle se vivait comme une authentique bourgeoise parisienne, aux obscures origines alsacienne et protestante. Elle avait poussé si loin la fiction qu’elle avait aussi inventé un métier à son père, celui de prof de maths. On ne parle pas de ces choses là, disait-on dans la famille si l’on interrogeait d’éventuelles origines juives. Ce diktat avait apparemment été entendu par Gilles, l’oncle de Léa, qui avait préservé la volonté de camouflage et le dénis de toute identité juive de sa mère, Jacqueline, future Veinstein (on s’interroge tout de même sur le fait qu’elle ait épousé un juif…). Lorsqu’une voisine pieuse de ses grands-parents remet à Léa un tampon qui garantissait la « pureté » casher des viandes contrôlées par Isaac au moment de l’abattage rituel, elle comprend que son oncle s’était débarrassé auprès d’eux d’un objet dont la symbolique le gênait autant qu’il avait gêné sa mère, qui avait pourtant conservé la relique…Pour Léa ce tampon devient le signe d’un retour, « comme un héritage, mais aussi une responsabilité ».

Son enquête va naturellement la conduire à une réflexion en profondeur sur sa propre identité. Elle qui, étudiante, fréquentait les cercles d’extrême gauche dans le sillage d’Alain Badiou, chez qui l’ambivalence envers Israël et les Juifs était notoire, constate que sa vie est « peu à peu ramenée vers le judaïsme ». Ses sujets d‘études, Walter Benjamin puis Kafka, son amour pour Solal dont la famille, juive pratiquante, lui fait partager les rituels et les fêtes, son regard sur la part juive de sa famille et son travail au Mémorial de la Shoah, vont convoquer chez elle un mélange d’évidences et de questionnements, sinon de doutes, au cours du long du chemin qu’elle emprunte pour mieux comprendre (et décider ?) qui elle est.
La question de la conversion se pose à elle, en particulier au moment où le projet de son mariage avec Solal prend forme. Mais l’exemple d’une camarade, avec qui elle partage des cours d’hébreu, la décourage. Pourquoi, elle qui n’est pas croyante, entreprendrait-elle tout ce périple, d’autant plus que le bain rituel, le mikve, ultime étape du processus, la repousse ? Séduite par la modernité du rabbin Delphine Horviller, elle examine à nouveau l’hypothèse de la conversion, qui deviendrait chez les libéraux la belle idée d’une confirmation. Passé un instant de tentation, elle renonce. Après tout, le mariage civil sera suivi d’une fête où le verre sera cassé, les mariés et les parents portés sur des chaises et où tout le monde criera Mazel Tov !
A la veille de leur voyage de noces en Israël, les amoureux apprennent qu’ils vont devenir parents. A son bonheur se mêlent à nouveau pour Léa questionnements et ambivalences. L’enfant est juif par sa mère dit la religion juive. Que sera notre enfant ? Comment, se sentant juive, peut elle réconcilier la contradiction entre « être juif » et tenir une distance vis à vis de la pratique de la religion ? Léa peut-elle, comme Ingeborg Bachmann (une amoureuse de Paul Celan) ou comme sa propre mère, non-juive, mais qui a connu son premier mari dans un kibboutz quand elle avait vingt ans, dire : « Je suis juive de coeur » ?
Léa aura un garçon. Son livre ne dit pas s’il sera finalement circoncis. Mais quelle plus belle image pouvait clore ce texte que celle du petit homme qui, lors de ses premiers pas, sort une kippa de sa boîte et la pose maladroitement sur sa tête ?
A l’heure où l’antisémitisme sévit encore et encore, Isaac est un texte d’autant plus bouleversant.
Lea Veinstein sera en 2020 commissaire d’une exposition au Mémorial de la Shoah consacré aux derniers survivants.
Isaac de Léa Veinstein, 144 pages, éditions Grasset, 2019
















