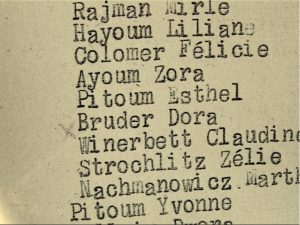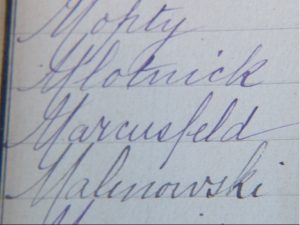Camille est un film bouleversant. Le réalisateur nous entraine sur les pas d’une jeune femme, photographe de 25 ans, Camille Lepage, qui après avoir vécu un an au Sud Soudan pour l’AFP a décidé de devenir indépendante. Elle est pétrie d’idéal et s’intéresse à la Centrafrique qui vient de basculer dans la guerre civile. Lorsqu’elle arrive à Bangui en 2013, la Séléka, coalition de rebelles majoritairement musulmans, a pris le pouvoir et fait régner la terreur. Les Anti-balaka se sont organisés en réaction. Camille se rapproche de l’un de ces groupes. Elle photographie l’horreur, la violence, les massacres. Elle n’est pas préparée à la folie de la guerre. Elle rentre chez elle épuisée pour fêter la fin de l’année en famille mais décide de repartir en février 2014 alors que toute la presse a déjà quitté la Centrafrique. En suivant un jeune chef anti-balaka dans ses patrouilles, elle trouve la mort à la frontière du Cameroun dans une embuscade. Elle a 26 ans.

« C’est une fille qui a dû partir au bout du monde pour se trouver. Une fille qui s’intéressait à des populations lointaines, comme moi. Elle était partie faire du photojournalisme, mais elle ne voulait pas être comme ces photographes de guerre qui zappent d’un conflit à l’autre et ne passent dans un pays que le strict minimum de temps pour en rapporter des photos choc. » C’est ainsi que Boris Lojkine présente Camille, l’héroïne de son deuxième long métrage de fiction (après Hope, 2014) et témoigne de sa proximité avec elle. Il a choisi pour son film de mêler la réalité et la fiction avec toujours, dit-il, « le souci de respecter une triple vérité : la vérité de Camille, la vérité de ce qu’est le métier de photojournaliste et la vérité des événements de Centrafrique au milieu desquels se déroule notre histoire ». Lorsqu’il décide de s’intéresser à elle, en 2016, il doit d’abord convaincre la famille de Camille Lepage. Des légendes ont circulé sur les circonstances de sa mort, jamais élucidées. Maryvonne, sa mère (incarnée par la merveilleuse Mireille Perrier), réticente au départ d’imaginer sa fille sous les traits d’une comédienne, finit par faire confiance au réalisateur et lui donne accès à l’ensemble des photos et des notes de Camille.

Nina Meurisse, actrice (Camille Lepage) lors du tournage d’une scène de lynchage à Bangui.
Boris Lojkine a reconstitué le parcours de Camille Lepage en Centrafrique en effectuant un gros travail d’enquête, soucieux de ne pas la trahir. Il se sent très proche d’elle, de sa manière de concevoir le métier en se mettant au service de la population, en vivant avec elle, loin des hôtels internationaux ou des villas d’expatriés. Il décide de tourner en Centrafrique, « la moindre des chose était de tourner sur place ». Il organise des casting sauvages dans les quartiers, à la fac, au stade de foot. Il voit entre trois cent et quatre cent personnes. En amont du tournage, il monte, en 2016, des stages d’initiation à la réalisation documentaire d’où une dizaine de stagiaires formés travailleront ensuite sur le film. Leurs présences, mêlées aux techniciens européens, a beaucoup aidé au tournage, l’a enrichi et facilité des négociations avec les autorités. A terme, ces ateliers vont conduire à la création d’un pôle audiovisuel pérenne.

Le visage rieur de Camille Lepage qui avait frappé le réalisateur lorsqu’il a découvert sa photo dans le journal, tellement solaire, en contraste absolu avec les horreurs qu’elle a photographiées, s’est fondu pour nous dans celui d’une comédienne incroyable : Nina Meurisse. Son sourire, sa joie enfantine, son humanité, son regard à la fois tendre et têtu, son optimisme, son énergie, son courage…Tout est contenu dans le jeu de Nina Meurisse, justement couronnée du Prix de la meilleure actrice au Festival d’Angoulême. Le réalisateur a trouvé dans la comédienne, outre sa ressemblance physique avec Camille Lepage, « une grande force morale, une véritable intériorité, une profondeur » qui sont quelques unes des belles qualités qui habitent visiblement son personnage.

L’implication de Camille Lepage en Centrafrique, Boris Lojkine la transmet avec force. Il reconstitue avec réalisme, mais sans aucun voyeurisme, la sauvagerie des scènes de foule, des exactions, la violence qui s’est emparée du pays. En mêlant les vraies photos de la reporter aux images du film, on comprend avec quelle précision le réalisateur a travaillé à la reconstitution tant des situations que des visages des hommes et des femmes que Camille a croisés, avec qui elle a pour une part vécu. Les regards de la photographe et du réalisateur ne font plus qu’un.

Le film dit aussi l’impasse dans laquelle la jeune fille avait conscience de s’être engouffrée. En pensant pouvoir briser les frontières entre elle et les autres, malgré les recommandations faites par l’un des journalistes qu’elle côtoie sur place (Bruno Todeschini, formidable !), elle est sans cesse renvoyée à son statut de blanche, de femme, d’ancienne colonisatrice.

Elle est une belle personne qui parvient toutefois à établir de vraies relations avec quelques révoltés qu’elle côtoie. Des scènes magnifiques de douceur sont proposées, en particulier avec d’autres femmes, lors d’un moment de toilette ou d’un repas qu’une mère a cuisiné pour elle ou encore de recueillement après l’assassinat de la jeune Leïla, l’un des personnages imaginés par le réalisateur pour construire son scénario. La bonté, l’humanité qui se dégagent de ces moment s’opposent radicalement à la violence des vengeances qui massacrent chacune des parties en guerre.
« Même si on me verra toujours comme une blanche, même si je suis dans une guerre qui n’est pas la mienne, j’ai le sentiment d’être ici à ma place », avait écrit Camille Lepage. Sa courte vie l’aura autorisée à cette certitude.
L’association « Camille Lepage – On est ensemble », fondée en septembre 2014 par la famille proche de Camille, ses parents et son frère, a pour but de promouvoir la mémoire, l’engagement et le travail de Camille, mais aussi de contribuer à la protection de photojournalistes travaillant dans les zones de conflit. Chaque année, l’association remet lors du festival Visa pour l’image à Perpignan un prix à un photojournaliste dont le travail témoigne d’un engagement personnel fort dans un pays, auprès d’une population ou pour une cause.
Camille, un film de Boris Lojkine, France/République centrafricaine, 2019, 90’.