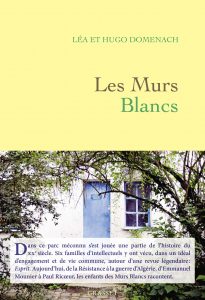Suzanne Valadon…Notre première rencontre a eu lieu lors de ma récente visite au Centre Pompidou pour découvrir l’exposition monographique qui lui est consacrée, la dernière avant la fermeture du musée pour travaux jusqu’en 2030 ( !) Cette visite fut pour moi un éblouissement, la découverte d’une œuvre si forte et d’une artiste profondément libre et moderne en dépit de son décalage avec les recherches artistiques de son époque, cubisme ou art abstrait. Peut-être est-ce l’une des raisons (pas la seule) qui l’ont marginalisée dans l’histoire de l’art ? En France, le public n’avait pas vu ses œuvres depuis cinquante ans, la dernière exposition Valadon remontant à 1967 au Musée d’art moderne.
Marie-Clémentine, Maria, Suzanne
Que se passe-t-il en 1880 pour une jeune fille de 14 ans, née Marie-Clémentine Valadon en 1865 à Paris d’une mère blanchisseuse et d’un père inconnu, lorsqu’elle fait une chute de trapèze la contraignant à abandonner son premier rêve artistique, celui de devenir acrobate ? Elle devient Maria, modèle pour des peintres tels Jean-Jacques Henner, Pierre Puvis de Chavannes, Auguste Renoir ou pour le sculpteur Paul-Albert Bartholomé. Mais aussi pour un jeune artiste, Henri de Toulouse-Lautrec avec qui elle entame une liaison passionnée. C’est Lautrec qui la baptise Suzanne. Ainsi naît Suzanne Valadon.

Crayon gras sur papier, Collection Galerie de la Présidence, Photo © Galerie de la Présidence, Paris
Nous la rencontrons très vite dans le parcours de l’exposition en découvrant les autoportraits qu’elle peindra tout au long de sa vie. Son regard n’est pas tendre avec son image : « Il faut être dur avec soi, avoir une conscience, se regarder en face. » Lorsqu’elle réalise à 66 ans son « Autoportrait aux seins nus » (1931), c’est comme si elle inscrivait le temps qui passe sans nostalgie ou coquetterie. Elle a gardé longtemps un corps parfait, mais une « tête ravagée », des yeux bleus d’une couleur intense. Elle se regarde en face et regarde les autres. Sa présence est saisissante. Elle nous regarde aussi….

Huile sur toile, Collection particulière, Suisse Photo © Akg-images
Autodidacte
Ce regard, elle l’a primitivement exercé pendant ses années de modèle : Valadon met à profit les séances de poses pour observer, écouter et apprendre les différentes techniques de dessin et de peinture des maitres qui la représentent. Edgar Degas découvre ses dessins dans les années 1890 et, très impressionné par son talent, lui déclare « Vous êtes des nôtres ! » Valadon ne posera jamais pour lui mais Degas lui ouvrira les portes de son atelier, lui apprendra la gravure en taille douce sur sa propre presse et lui achètera de nombreux dessins. Il l’appelait « cette diablesse de Maria ».

Paris, Centre national des arts plastiques
En dépôt au musée de Grenoble,
Photo © Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix
Dessin et peinture
Nous sommes entrainés sur les deux rives de son travail, le dessin et la peinture. Le talent de cette autodidacte est inouï. « J’ai dessiné follement pour que, quand je n’aurais plus d’yeux, j’en aie au bout des doigts. » Lorsqu’elle présente ses dessins pour la première fois au public lors du Salon de la Société́ nationale des Beaux-Arts en 1894, les critiques les remarquent très vite. « Âpreté» et « dureté» sont les termes en lesquels ils les décrivent. Edgar Degas, loue ses dessins à la ligne « dure et souples ».

Fusain sur papier calque , Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Crédit Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/ Dist. GrandPalaisRmn
Nus, corps féminins et masculins
Son expérience de modèle ne vaut pas uniquement comme moment de formation artistique. Il fonde son inspiration. La peinture de nus, territoire traditionnellement masculin, sera son sujet central, tant dans ses dessins que dans sa peinture. Réalistes et sans concession, ses nus nous impressionnent par leurs vérités, la force de leurs traits. Lorsqu’elle peint des corps de femmes, ils ne sont jamais idéalisés ou offerts selon le désir des peintres masculins. Son œuvre, taxée alors par la critique « d’absence de féminité », de « virilité », de « vulgarité » est habitée par une sexualisation qui inverse le modèle dominant …Et toujours libre par rapport à la bienséance, elle s’aventure en pionnière de l’histoire de l’art en représentant un nu masculin en grand format. En 1909, avec son tableau Adam et Ève, elle célèbre sa relation amoureuse avec son jeune amant et futur mari André Utter. Les corps de la femme et de l’homme nous font face, totalement nus dans la première version de l’œuvre. Mais l’audace est vite réprimée car Valadon doit recouvrir les parties génitale d’Utter/Adam d’une feuille de vigne, sans doute pour pouvoir présenter le tableau au Salon des Indépendants en 1920.

Huile sur toile, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne Crédit Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prevost/ Dist. GrandPalaisRmn
Son monde, son inspiration
Elle impose sa vision en rupture avec les conventions de son époque et construit son monde -pour paraphraser le titre de la première version de l’exposition crée en 2023 à Pompidou- Metz, « Suzanne Valodon, un monde à soi »-. Son monde est celui qui l’entoure, famille, amours, amis. Il se confond avec son oeuvre. Sa mère Madeleine Valadon, son fils, le futur peintre Maurice Utrillo, son second mari André Utter sont ses modèles de prédilection.

Paris, musée d’Orsay, en dépôt au Centre Pompidou, Musée national d’art moderne,
Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Christian Jean / Jean Popovitch
Elle a 18 ans lorsque nait son fils reconnu tardivement par le peintre catalan Miquel Utrillo. Alcoolique précoce, Maurice est diagnostiqué schizophrène à partir de 1901. Pour le soigner, Valadon lui enseigne la peinture. Il devient son premier élève et le succès du fils dépassera celui de la mère. Elle rencontre en 1909 un ami de Maurice, André Utter. Elle a 44 ans, lui 23. Il devient son amant puis son mari après son divorce avec Paul Mousis, son premier mari. Elle entretiendra avec Utter une relation très forte, voire orageuse : « Elle vivait uniquement pour la peinture, pour faire l’amour avec Utter et se disputer avec lui », témoigne l’une de ses anciennes élèves, Germaine Eisenmann au Nouvel Observateur en 1967. Valadon, Utrillo, Utter formaient aux yeux de certains la « trinité maudite ». Outre sa relation passionnelle avec Toulouse-Lautrec, nous apprenons au détour d’un portrait d’Erik Satie qu’elle vécut une histoire brève et intense avec le musicien.
Sa famille élargie, sœur, nièce, sa belle-fille Lucie Valore, la famille Utter lui inspire plusieurs tableaux.

Lyon, musée des Beaux-Arts
Crédit Image © Lyon MBA – Photo Alain Basset
Mais Suzanne peint aussi des anonymes, des corps ou des personnalités qui l’intéressent.

Lucien Arkas Collection
Photo © Hadiye Cangokce
« Je peins les gens pour apprendre à les connaitre » a dit Suzanne Valondon ou encore « Quels que soit la dureté des temps, les déboires subis, il faut peindre dans la vérité avec amour.

Collection particulière
Photo © Matthew Hollow
Plus tard, dans les années 1920, elle exécutera des commandes de portraits de ses amis du monde de l’art, tous plus intenses les uns que les autres.

Italie, Bergame, collection particulière
Photo © Galleria Michelangelo
Natures mortes et paysages
Tardivement dans son œuvre s’inscrivent paysages et nature mortes. « La nature m’apporte le contrôle de vérité solide pour la construction de mes toiles, conçue par moi mais motivée toujours par l’émotion de la vie » a écrit Valadon. Certaines natures mortes peintes dans son atelier du 6 de la rue Cortot laissent deviner son décor, son univers. On se prend à l’imaginer là, au milieu de ses amis du Montmartre bohème, Erik Satie, Francis Carco, Pierre Mac Orlan, Max Jacob, Jules Pascin…

Paris, musée d’art moderne de Paris,
Crédit Photo: CCØ Paris Musées / Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Son autre lieu de vie, le château Saint-Bernard non loin de Lyon, où Utrillo, Utter et elle ont chacun leur atelier, lui inspire paysages et natures mortes. « C’est sans nul doute des sens les moins intellectuels, les sens les plus viscéraux qu’elle a acquis son expérience du monde (…) c’est de la même vérité chaude que vivent chez elle natures mortes et paysages », nous suggère Bernard Dorival dans sa préface du catalogue de l’exposition Valadon de 1967.
Cette « vérité chaude » résume parfaitement ce qui se dégage de la visite de cette exposition, un régal d’audaces, de couleurs, de vérités.

Suzanne Valadon 15 janvier - 26 mai 2025 Centre Pompidou https://www.centrepompidou.fr/fr/
Publications : Catalogue de l’exposition, Suzanne Valadon, sous la direction Chiara Parisi, 280 pages, 240 illustrations, 42 € Album de l’exposition, Suzanne Valadon, sous la direction de Nathalie Ernoult, 60 pages, 10,50 € Valadon, Clément Dirié, Les Pérégrines, 2025, collection Icônes,220 pages,16 €