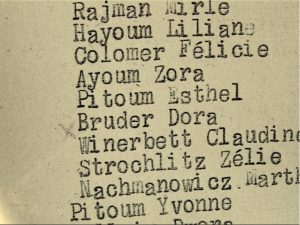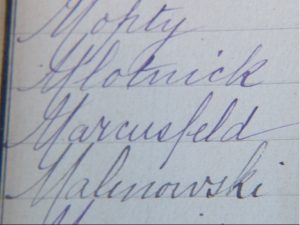Qu’est-ce qu’une Papicha ? Dans le vocabulaire algérois, papicha désigne une jeune femme drôle, jolie, libérée. Mounia Medour met en scène, dans son premier film de fiction, une bande de papicha, une bande de filles dans l’Algérie des années 90, période qualifiée de « décennie noire » ou de guerre civile algérienne, pendant laquelle le mouvement islamiste algérien, mené d’abord par le FIS (Frot Islamiste du Salut), tente d’imposer ses lois et ses valeurs.

Le film s’ouvre sur une scène fondatrice : Nedjma et son amie Wassila s’échappent à la nuit de leur cité universitaire pour s’engouffrer dans le taxi qui les attend. Les étudiantes sages, en jogging, opèrent alors dans la voiture leurs mues en « belles meufs », enfilant des robes scintillantes, maquillant leurs yeux et leurs bouches, fumant des cigarettes. Elles passent miraculeusement à travers un barrage de police grâce aux voiles dont elles recouvrent rapidement leurs cheveux. Le décor est planté : il faut transgresser les limites pour pouvoir être une jeune fille libre dans ce pays, à cette période.

La fin de l’insouciance est le thème de ce film qui met le corps des femmes au centre de son propos. Nedjma est une styliste en herbe. Elle fabrique des robes qu’elle vend à ses copines dans les toilettes d’une boite de nuit où elles se retrouvent pour danser. Filmées au plus près de leurs visages et de leurs gestes, elles aiment la vie, les garçons, la rigolade et l’amour. Puis, petit à petit, les femmes en hidjab sont partout : elle font irruption en patrouilles menaçantes dans les salles de classe, dans les chambres des filles, des affiches à leur image sont collées sur les murs de la ville comme unique modèle féminin puis sont placardées à l’intérieur de l’université. Une enceinte se construit, chaque jour plus haute, autour de la cité U pour « protéger » les étudiantes des tentations de la vie extérieure. Les reportages à la télé ou la radio témoignent des attentats quotidiens et des massacres perpétrés par les intégristes. Autant de messages anxiogènes d’une situation politique qui cherche à museler les libertés. Liberté de penser, liberté de circuler, liberté d’habiller son corps selon son goût ou la mode des magazines.

Les Papicha ont conscience des dangers qui les guettent mais décident de continuer à vivre leurs vies, de braver les interdits. Nedjma (extraordinaire Lyna Khoudri révélée dans « Les Bienheureux » de Sofia Djama en 2007 et actuellement à l’affiche de la série Les Sauvages sur Canal +) veut continuer à créer ses robes et n’envisage pas une seconde de quitter son pays, Wassila (formidable Shirine Bouteilla, youtubeuse au million de followers dans la vraie vie) soutient son amie et croit par ailleurs au grand amour, Karina (lumineuse Zahra Doumandji) rêve de quitter l’Algérie pour un Canada idéal; quant à Samira (incarnée par la slammeuse Amina Hilda), la seule religieuse d’entre elles, elle est magnifique dans ses contradictions, entre respect de la tradition et révolte contre la soumission.

L’assassinat de sa soeur Linda, exécutée à bout portant, pratiquement sous ses yeux et ceux de leur mère, par une femme voilée, fait basculer la vie de Nedjma (et le film). Linda a été supprimée car elle était journaliste et trop bien habillée. L’heure est à la résistance. Sa colère, sa rage tiennent la jeune styliste debout et guident sa détermination. Elle se lance dans un pari fou : organiser un défilé de mode dans la fac, en créant des robes coupées dans des haïks. Ce long morceau de tissu blanc, symbole de pureté et d’élégance, était devenu un symbole de la résistance nationale algérienne contre la politique coloniale française. Nedjma noircit ses carnets de croquis, crée des modèles tourbillonnants sans oublier la robe de mariée. Ce tissu symbolisera une nouvelle résistance, celui de la matière de robes qui dévoilent les corps, celui de l’étoffe à l’éclatante blancheur opposée au tissu noir des niqab provenant d’Arabie Saoudite. Les plans des mains de Nedjma, modelant avec patience et précision les tissus pour leur donner forme, sont magnifiques.

On ne racontera pas ici les obstacles et les victoires, les espoirs et les déceptions, les joies et les douleurs de ces jeunes femmes en colère. On dira en revanche, qu’il faut aller voir ce film, manifeste féminin, sinon féministe contre l’oppression des femmes, pour la liberté de leurs corps et de leurs destins. On s’insurgera contre quelques critiques cinématographiques qui font à ce film des reproches injustes : l’un l’accuse de ressembler trop à Mustang (tant mieux s’il existe un cinéma arabe féministe qui combat l’obscurantisme !), l’autre déplore son manque de recul et son énergie qui confinerait à la frénésie, un troisième dénonce des invraisemblances historiques, beaucoup trouvent ce film maladroit et trop démonstratif …. Mounia Medour a construit un scénario en partie autobiographique, choisissant d’abandonner son expertise de documentariste, au profit de la fiction. Elle a tourné en Algérie, pays qui a pourtant, à ce jour, annulé la sortie du film dans ses salles. Le choix de faire parler les personnages en « françarabe », un mélange d’arabe et de français, donne aux dialogues un rythme et une vérité tonique. L’énergie frénétique qui est reprochée à la réalisatrice permet, au contraire, de nous raconter un moment de l’histoire de son pays à travers les yeux d’une jeune femme dont la beauté éclatante est son principal défaut aux yeux des intégristes. Même si ce film n’est pas retenu comme un grand film dans l’Histoire du cinéma, l’émotion qu’il réussit à nous procurer relègue loin les questions d’éventuelles maladresses ou d’incohérences historiques. Nous nous réjouissons de savoir Papicha représenter l’Algérie aux Oscars 2020.
Papicha, 105 min – France, Algeria, Belgium, Qatar – 2019 Sélection Un certain regard, Festival de Cannes 2019 Meilleur scénario, meilleure actrice, Prix du public, Festival du film francophone d'Angoulême 2019