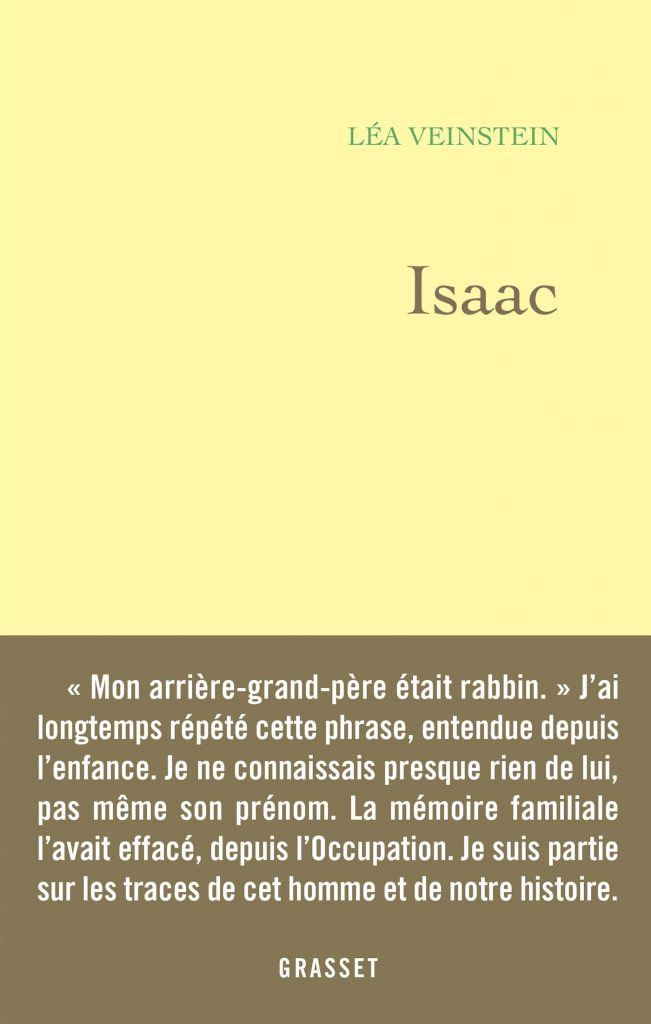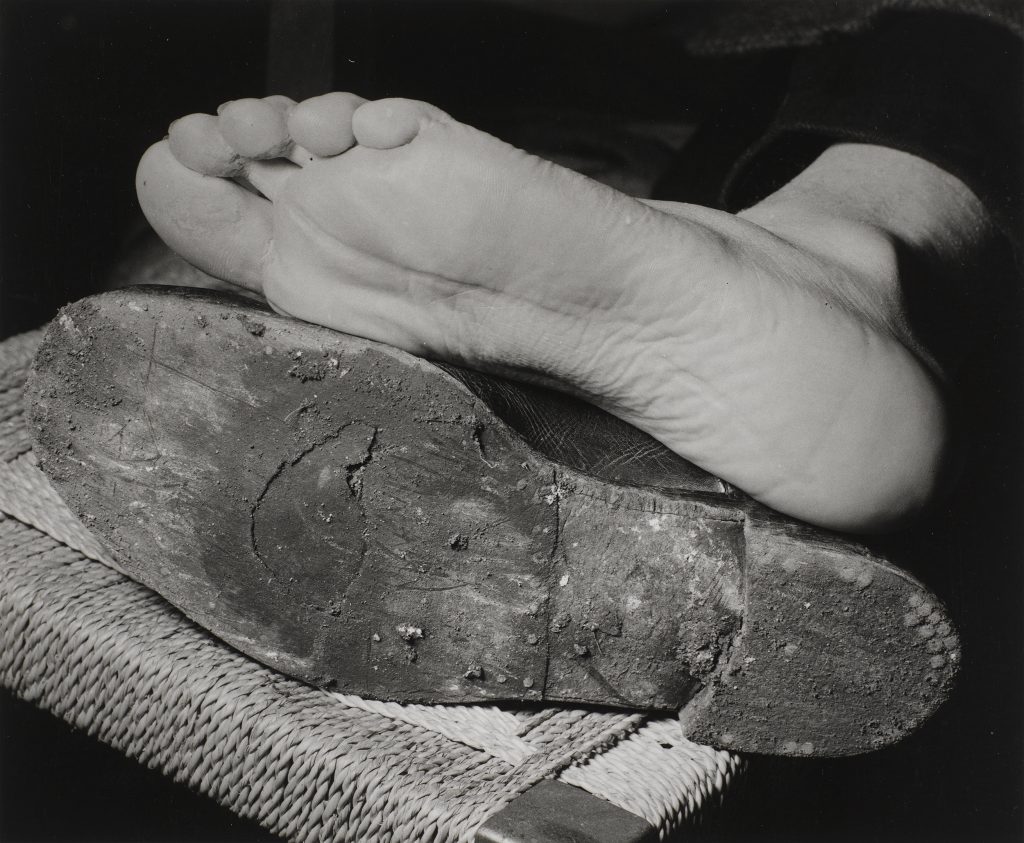Parmi les superbes expositions proposées cet automne à Paris, celle du musée de l’Orangerie nous permet de découvrir la collection exceptionnelle de l’un des principaux marchands d’art moderne des années 1950 aux années 1970, Heinz Berggruen (1914-2007).

Maigres mots de l’homme économe, 1924 Museum Berggruen, Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz Photo © BpK Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen / Jens Ziehe
Un exilé entre plusieurs mondes
Découvrir une collection c’est aussi aller à la rencontre de la vie et de la personnalité de celui qui l’a constituée. Le parcours d’Heinz Berggruen est, comme l’écrit son fils Olivier dans le catalogue de l’exposition[1], « une trajectoire faite de détours inattendus, celle d’un exilé permanent à cheval entre plusieurs mondes, cultivant malgré lui un certain cosmopolitisme éloigné du milieu conventionnel de son enfance. » De Berlin où il nait en 1914 dans une famille de la moyenne bourgeoisie juive, à la France où il entame des études de lettres, il émigre en 1936 aux Etats-Unis pour fuir les persécutions nazies. Étudiant, il complète sa maigre bourse en donnant des cours d’allemand ou en animant des petites fêtes au piano et à l’accordéon. C’est dans l’une de ces soirées qu’il rencontre celle qui deviendra sa première femme, Lillian Zellerbach. En dépit de ce mariage, il continuera à se sentir « terribly European » en Amérique. Il poursuit sa carrière de journaliste entamée à Berlin et publie ponctuellement quelques articles. Grâce à ses critiques régulières, il est embauché par le Museum of Modern Art de San Francisco en 1939. Sa mission d’assistant de l’artiste mexicain Diego Rivera pour une exposition va bouleverser sa vie : « La fascination qu’exerça sur moi Rivera est certainement ce qui me décida à chercher mon bonheur dans l’art », écrit-il dans sa passionnante autobiographie[2]. Il vivra alors une relation aussi intense que brève avec Frida Kahlo que Rivera avait tenu à lui présenter…Naturalisé américain, il est mobilisé en 1942 à l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Allemagne nazie. Il rentre enfin dans son pays natal en 1945 et collabore à la revue Heute, où il publie essentiellement des articles consacrés à la vie artistique. Mais c’est à Paris, à la faveur d’une mission à l’Unesco dont il se lasse rapidement, qu’il se lance dans le commerce de l’art et ouvre sa première galerie Place Dauphine. Ses voisins ne sont autres qu’Yves Montand et Simone Signoret. Ils cherchent à s’agrandir et lui rachètent son petit local (dont ils feront leur cuisine), lui permettant ainsi d’ouvrir en 1949, au 70 rue de l’Université, la galerie, « Berggruen &Cie », qu’il dirigera pendant plus de trente ans.

© Berggruen Archive. Photo: U.H. Mayer, Düsseldorf
Marchand d’art
Son activité de marchand d’art (il n’aimait pas le terme galeriste), est présentée à la fin du parcours de l’exposition de l’Orangerie. « Mon activité reposait essentiellement sur un intense commerce de gravures et je ne tardai pas à faire partie, à Paris, des marchands d’art les plus actifs dans le domaine de la lithographie originale et des eaux fortes d’artistes célèbres, tels que Chagall, Miró et surtout Picasso.» 3] Sans oublier Matisse.

Maquette pour l’affiche de l’exposition « The Sculpture of Matisse » (Tate Gallery, Londres, 1953) Museum Berggruen, Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz Photo © Bpk / Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen / Andres Kilger
© Succession H. Matisse
On découvre une partie des affiches et des catalogues des expositions qu’il a organisées. La première, notoire, a lieu du 14 février au 8 mars 1952, accompagnée d’une monographie de Paul Klee, son artiste fétiche puisque l’œuvre initiale que Berggruen a acquise en 1940 est un dessin de Klee, devenu son « talisman ».

Couverture du catalogue de la galerie Berggruen & Cie Paul Klee, 24 gravures, collages, 1952, Berlin, Museum Berggruen, Neue Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin
Image avec l’aimable autorisation de la famille Berggruen
Il consacrera à l’artiste plusieurs expositions ainsi qu’à Picasso, Matisse ou Miró mais aussi à des peintres alors plus confidentiels à l’époque tels Kurt Schwitters, Karel Appel, Alberto Magnelli, Robert Motherwell, Antioni Tàpies, Serge Poliakoff ou Pierre Soulages. Il réussira à convaincre Dora Maar d’exposer en 1957 ses tableaux peints à Ménerbes où elle s’est isolée du monde. Mais elle refusera d’assister au vernissage.
Berggruen fut marchand d’art et collectionneur mais aussi un éditeur important à en juger par la qualité des catalogues qui accompagnaient les expositions (toujours des petits formats), des monographies d’artistes ou de véritables livres d’art. Sa curiosité lui a permis de rencontrer des acteurs majeurs de la vie intellectuelle parisienne et internationale, outre les artistes, des poètes, historiens, marchands et collectionneurs. Les contributeurs de ses catalogues illustrent l’excellence de ses réseaux.

Collectionneur
« Ma collection débuta de façon tout à fait modeste, aussi modestement que ma galerie, avant de devenir, au fil des années, une passion. Plus tard, il m’arriva d’avoir l’impression que ma galerie n’était qu’un prétexte pour agrandir ma collection. Petit à petit, je devenais mon « meilleur client ».[4]En effet, c’est son activité de marchand qui finance celle de collectionneur.

Le Cahier bleu, 1945
Museum Berggruen, Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Photo © Bpk / Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen / Jens Ziehe © Succession H. Matisse
Le texte de salle introductif de l’exposition nous prévient : « En collaboration avec le Museum Berggruen / Neue Nationalgalerie Berlin, cette exposition met en lumière un échantillon de la collection personnelle du marchand d’art, qui rassemble des chefs-d’œuvre de Picasso, Klee, Matisse et Giacometti. Échantillon d’un goût qui s’est forgé tout au long de sa vie, cette collection démontre un attachement profond à l’art moderne et à ses figures emblématiques, auxquelles Berggruen restera toujours dévoué́. »

Pablo Picasso (1881-1973) Arlequin assis
1905, Museum Berggruen, Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Photo © Bpk / Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen / Jens Ziehe
© Succession Picasso 2024
Une centaine d’œuvres nous sont présentées, dans un parcours thématique. Klee et Picasso dominent, répondant ainsi aux prévalences de Berggruen qui écrit à leurs sujets : « à mes yeux ils représentent les créateurs les plus importants de la première moitié du XXème siècle.[5] » Contrairement à Picasso que le collectionneur a rencontré dès 1959 par l’intermédiaire de Tristan Tzara, avec qui il a noué une relation amicale et professionnelle profonde jusqu’à la mort de l’artiste, il ne rencontrera jamais Paul Klee. Mais sa fascination pour l’artiste l’entrainera à acquérir un ensemble magistral de ses œuvres et à contribuer à promouvoir Klee comme un artiste majeur de l’art moderne. « C’est un monde de silence et de sons légers, de poésie et de musique douce. Ce royaume intime et caché réserve à tous ceux qui y pénètrent de nouvelles découvertes et de nouvelles surprises.», suggère Berggruen dans son autobiographie à propos de Klee. Quant à Picasso il écrit modestement : « Je n’ai jamais prétendu pouvoir explorer la richesse de Picasso dans toute sa diversité́, mais j’ai tenté, en collectionnant ses œuvres avec persévérance et rigueur, de donner une idée du cosmos de cet homme qui, comme aucun autre, incarna tout un siècle.[6] » L’exposition présente plusieurs pièces somptueuses de Giacometti.

1948 – 1949
Museum Berggruen, Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Photo © Bpk / Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen / Jens Ziehe
© Succession Alberto Giacometti
Berggruen prend sa retraite de marchand d’art dans les années 1980 pour se consacrer à l’avenir de sa collection. Il offre de nombreuses œuvres de Klee au Musée national d’Art moderne à Paris (1972), ainsi qu’au Metropolitan Museum of Art à New York (1984).) Il fera don à Pompidou du lustre en plâtre de Giacometti suspendu dans sa galerie de la rue de l’Université et au Musée d’Orsay du Joueur de cartes de Paul Cézanne.

1949 – 1950, Paris, Centre Pompidou – Musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle, don de M. Heinz Berggruen, 1983, AM 1983-468
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist. RMN-Grand Palais / Adam Rzepka © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2024
C’est une chance de pouvoir admirer deux oeuvres de Cézanne dans l’exposition parisienne car Berggruen s’était séparé d’œuvres de Van Gogh, Seurat et Cézanne pour resserrer sa collection autour du XXème siècle.

Madame Cézanne
Vers 1885 Prêt de la famille Berggruen
Museum Berggruen, Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz Photo © Bpk / Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen / Jens Ziehe
Sa collection est exposée dans plusieurs musées, comme le Musée d’art et d’histoire de Genève (1988) ou la National Gallery à Londres (de 1991 à 1996). Berggruen reprend la nationalité́ allemande et retourne vivre à Berlin en 1996 où sa collection est inaugurée la même année dans un bâtiment en face au château de Charlottenburg. C’est un véritable succès et les musées nationaux de Berlin en font l’acquisition en 2000. En 2004, pour ses quatre-vingt-dix ans, Heinz Berggruen voit le bâtiment et sa collection renommés Museum Berggruen.

Paysage en bleu, 1917 Prêt de la famille Berggruen
Photo © Bpk / Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen / Jens Ziehe
« Sur la voie principale du commerce de l’art, j’ai rencontré quelques-uns des artistes les plus importants de ce siècle (…) Si mes tableaux procurent à ceux qui les verront dans les prochaines années à Berlin, un peu de la passion que j’ai éprouveé en les acquérant, et que j’éprouve à chaque fois que je les vois, alors ce chemin-là, je ne l’aurais pas parcouru en vain ». [7] Pour notre plus grand bonheur, nous avons la chance de les découvrir au musée de l’Orangerie jusqu’au 27 janvier 2025.
[1] [1] Heinz Berggruen, un marchand et sa collection, ed. Musée de l’Orangerie/Flammarion
[2] « J’étais mon meilleur client », Souvenirs d’un marchand d’art, l’Arche, 1997
[3] idem
[4] idem
[5] idem
[6] idem
[7] idem
Jusqu'au 27 janv.2025 Musée de l'Orangerie Chefs-d’œuvre du Museum Berggruen / Neue Nationalgalerie Berlin UN MARCHAND ET SA COLLECTION